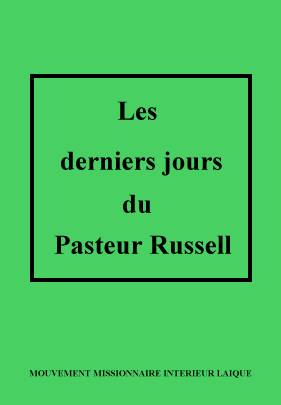
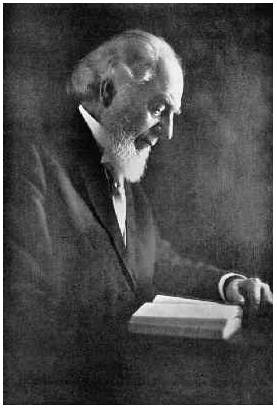
Plan
du site -----
Retour page
d’accueil ------ La vérité sur son œuvre
------ Volume
1er Le divin plan des âges ------ Les 6
volumes
------ Autres écrits de C.T. Russell ------ Questions
sur : la vie, la mort, l’au-delà
LES DERNIERS JOURS DU PASTEUR RUSSELL
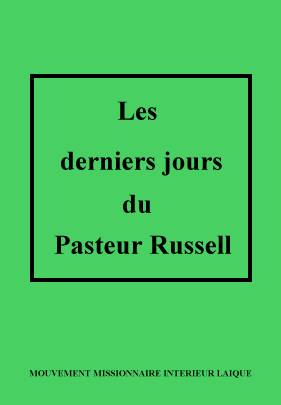
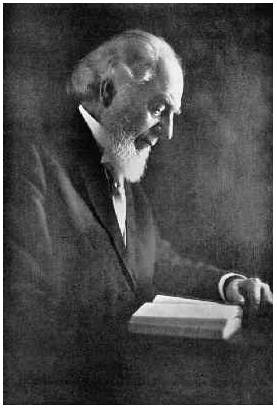
LE
LUNDI 16 octobre 1916 à 17 h 00, frère Russell quitta le foyer de Béthel à
Brooklyn-New York, pour la dernière fois. A midi, il avait informé sa plus chère
famille sur la terre qu'il s'attendait à être éloigné d'elle pendant quelque
temps, et lui avait exprimé l'espoir que, durant son absence, tous ses membres
seraient heureux et prospères sous les bénédictions du Seigneur. Il dit aussi
qu'il espérait que lui et son compagnon de voyage se réjouiraient dans le
service du Seigneur. Puis, pendant que lui et la famille restaient à leurs
places, il adressa une prière solennelle commençant par ces mots :
«
Ô Seigneur, de Ta grâce
promise
«
Viens remplir nos cœurs
consacrés »,
et,
tranquillement, il se retira dans son bureau. Là, il dicta neuf lettres donnant
des instructions à divers collaborateurs concernant leur tâche. A l'heure fixée,
il sortit pour ne plus jamais revenir, disant « au
revoir » aux amis au
moment où il traversait le hall pour sortir et se rendre à la gare.
Lorsque
le train de Lehigh-Valley quitta Jersey-City à six heures du soir, il emportait
notre précieux frère pour son dernier voyage de Pèlerin, voyage qui devait
s'achever au ciel. Ayant, la veille, tenu des réunions publiques à Providence
et à Fall River, il partait fatigué et, en conséquence, ne dicta pas ce
soir-là en chemin de fer, comme il en avait l'habitude. Il se retira
effectivement plus tôt que d'ordinaire en disant « bonne
nuit », comme il le
faisait d'habitude. Le matin, répondant à la question pour savoir comment il
s'était reposé, il fit la même réponse qu'il avait faite au cours de ses récents
voyages : « Sur
les deux côtés »,
voulant dire évidemment qu'il avait changé de côté fréquemment durant la
nuit.
Il
nous avait souvent déclaré ces derniers temps qu'il dormait rarement, restait
éveillé toute la nuit et réfléchissait assez bien jour et nuit. Il avait
dans son cœur le souci de toutes les églises, et ses souffrances physiques ne
lui laissaient guère de repos. Il mangeait toujours avec modération et notait
soigneusement l'effet de tout ce qu'il mangeait ou buvait. Fréquemment, il
partageait sa ration avec son compagnon afin d'économiser. Sa coutume
invariable était de rendre grâces avant les repas, soit dans les hôtels, dans
les trains, n'importe où. Il avait une belle manière de mettre à l'aise celui
qui voyageait avec lui, et de ne pas le considérer simplement comme un
serviteur, en lui remettant au début du voyage assez d'argent pour couvrir
toutes ses dépenses occasionnelles de route. Puis, il s'arrangeait de manière
que chacun payât à son tour les dépenses de l'autre : il payait toutes
les dépenses d'un jour et son compagnon payait toutes celles du lendemain, et
ainsi de suite, durant tout le parcours.
Le
mardi matin, nous traversâmes la frontière du Canada ; et, spirituellement, il
me demanda : « N'avez-vous
pas senti que le pont se voûtait en son milieu au moment où nous l'avons
traversé ? ». A propos du Canada, il dit : « Ils ne nous molesteront pas plus longtemps que nous ne mettons
de temps pour le traverser ! quant à visiter le Canada, je n'ai aucun désir de
le faire s'ils ne veulent pas de moi ». Dans deux précédentes occasions
il avait eu de sérieuses difficultés à Hamilton (Ontario) ; mais, cette fois,
il ne reconnut même pas Hamilton quand nous y passâmes. Nous changeâmes de
train et d'heure à London. Peu après, nous fîmes notre premier arrêt à Détroit,
le mardi après-midi. Ce fut là que commencèrent les épreuves de frère
Russell ; elles s'accrurent constamment et devinrent de plus en plus pénibles
et sévères jusqu'à la fin du voyage. Il était physiquement faible et las ;
il écouta pourtant avec patience les doléances qu'un frère lui exposait, et
fit tout ce qu'il put pour en réconcilier deux autres. Le chauffeur nous
conduisit par erreur où il ne fallait pas et nous fit perdre un temps précieux.
Les correspondances de notre tramway furent médiocrement assurées. Une affaire
de la plus grande importance, en rapport avec l’œuvre de la Moisson, échoua
complètement. Il en fut très déçu et troublé.
DIFFICULTÉS
SUR LA ROUTE
A
bord du « Père Marquette », en route pour Lansing (Michigan), il
fit la remarque suivante :
« Nous
ne nous attendions pas à voyager ensemble vers Lansing quand nous nous sommes
vus pour la première fois », et son auditeur fut surpris de constater
qu'il se souvenait bien de notre première rencontre à Allegheny des années
auparavant. C'était sa manière de manifester son intérêt et son amour pour
celui qu'il avait pris avec lui du Béthel pour l'accompagner dans son dernier
voyage. Une belle assistance était présente à la réunion publique de Lansing
; mais, pour une raison indéterminée, l'intérêt fléchit et beaucoup s'en
allèrent ; à tel point que frère Russell en parla après et parut intrigué.
A la gare, il s'entretint avec un cher frère jusqu'à minuit sur des questions
d'affaires et fit alors remarquer qu'il désirait se retirer.
Le
lendemain matin, mercredi, à sept heures, nous nous attendions à entrer à
Chicago, mais nous nous trouvâmes, au lieu de cela, détournés à Kalamazoo,
sans aucune information précise sur ce qui devait suivre. Les débris d'un
train de marchandises, détruit durant la nuit, étaient la cause du retard,
nous dit-on, et nous devions faire un détour de 50 miles [environ 80 kilomètres
— Trad.] pour arriver à destination. Il n'y avait pas de wagon-restaurant
dans le train et il ne nous fut pas possible de nous procurer quoi que ce fut
pour manger, faute de renseignements. Une boîte de sandwichs au beurre d'amande
qui nous avait été donnée par un frère prévenant de Brooklyn vint à point.
Elle constitua notre déjeuner et, plus tard, notre dîner. Ayant atteint
Chicago avec un retard de quelques six heures et demie, nous apprîmes que nous
avions manqué notre correspondance pour Springfield et que, par conséquent, il
nous serait impossible de tenir notre engagement pour cette localité, quelle
que fût la solution envisagée. Ce fut à Chicago que son endurance physique
fut poussée à l'extrême limite. Les circonstances nous obligèrent à marcher
pendant plusieurs `miles' jusqu'à ce que l'auteur de ce récit se sentît de
plus en plus fatigué et comprît que frère Russell devait être également exténué,
quoique aucune remarque n'en fût faite. Tout ceci se passait après quelques
heures seulement de repos pris la nuit précédente et avec très peu de
nourriture.
A
la gare de l'Union de Chicago, alors que nous faisions des préparatifs pour
prendre le train du mercredi soir pour Kansas City, via Springfield, une dame du
Sud qui venait de passer quelque temps à visiter Chicago avec sa fille et son
fils s'approcha de frère Russell en se présentant comme la fille d'une
certaine dame qui avait jadis vécu à Allegheny, croyante dans la Vérité, et
dont les funérailles avaient été dirigées par frère Russell. Elle expliqua
que tout en n'étant pas « une
des nôtres », dans le plein sens du terme, elle était croyante cependant
et était spécialement intéressée par le PHOTO-DRAME DE LA CRÉATION au point
qu'elle était en train d'écrire un livre à son sujet ayant pour titre
« L'Âge d'Or ». Elle désirait avoir un exemplaire du SCÉNARIO.
Ce SCÉNARIO fut à la fois promis et expédié. Frère Russell, comme de
coutume, s'enquit de sa consécration et de celle de sa fille, et elles lui
dirent qu'elles y réfléchissaient sérieusement.
Que
de fois l'ai-je entendu demander aux gens dans les trains, les gares, les hôtels,
partout : « Êtes-vous consacré ? ». Presque toujours il amenait
cette question. De nombreuses occasions s'offraient à lui, car les gens le
reconnaissaient partout, voulaient lui parler ou seulement lui dire quelques
mots. Les gens dans le train le connaissaient : garde-freins, surveillants de
salon et de wagons, et voyageurs. Dans les gares, dans les hôtels, dans les
rues, partout, il était reconnu. Maintes fois, les gens venaient vers moi dans
le train et s'informaient : « Ce
monsieur n'est-il pas le Pasteur Russell ? » ajoutant : « Je le connais par sa photo dans le journal »
ou bien « Je l'ai entendu parler à tel et tel endroit ».
Parfois, l'ayant vu circuler dans les couloirs du train, ils demandaient :
« Quel est cet homme distingué que vous accompagnez ? ». Nous
avons pu, de cette manière, envoyer beaucoup de volumes 1 et d'autres imprimés
de la Société.
PERTE
DE LA VALISE DE FRÈRE RUSSELL
Il
était environ minuit quand nous arrivâmes à Springfield où nous devions nous
procurer des tickets. Frère Russell avait veillé tard et voulait rester debout
jusqu'à notre arrivée à Springfield ; mais, cédant à une aimable
persuasion, il laissa le travail à faire entre mes mains et se retira. La nuit
était
A
Kansas City, le jeudi matin, nous rencontrâmes tant de difficultés pour
acheter nos tickets pour l'Ouest qu'il fut nécessaire que je coure à travers
la ville sous la pluie et avec un tel retard que frère Russell fit là ce que
nous ne l'avions jamais vu faire : courir pour attraper le train. Nous disons
ces choses pour montrer combien ce voyage fut différent de tous ceux qui
l'avaient précédé et comment ses épreuves grandissaient au fur et à mesure
qu'il poursuivait son voyage. Nous arrivâmes à Wichita jeudi après-midi, à
temps pour une réunion de l'après-midi ; mais cette réunion et un autre
travail à Wichita furent plus ou moins troublés par la perte de la valise de
frère Russell. Le cher frère qui s'était chargé de la valise l'avait placée
sur le marchepied de son auto qu'il préparait et, en démarrant, il avait oublié
de la prendre avec lui, de sorte qu'elle était tombée quelque part entre la
gare et le lieu de la réunion. Cet incident empêcha l'auteur du présent
article de prendre des notes sur le discours et l'obligea à retourner avec le
frère, afin de retrouver l'objet perdu. Après avoir fait tout ce que nous
pouvions sans succès, nous finîmes par faire insérer une annonce dans le
journal, promettant une récompense à la personne qui rendrait la petite
valise.
Nous
restâmes là le lendemain dans l'espoir de la retrouver et fîmes quelques
achats d'articles nécessaires dont frère Russell aurait besoin en route. La
conférence publique eut lieu le soir et frère Russell était très fatigué
lorsqu'elle fut terminée. Le lendemain matin, il sortit de sa chambre plus tard
que de coutume ; mais, après déjeuner, nous travaillâmes ensemble jusqu'à
midi à divers documents et lettres qu'il avait dictés. A ce moment, un
voyageur de commerce de belle apparence se présenta à frère Russell comme intéressé
à ses ouvrages. Il était le fils d'un pasteur éminent d'Allegheny qui, à un
certain moment, s'était durement opposé à frère Russell et à son
œuvre. La
femme de ce monsieur était aussi intéressée ; nous la rencontrâmes ensuite
à la conférence publique de Dallas (Texas). Ayant fait tout ce qu'il était
possible pour retrouver la valise égarée, en fin de compte nous abandonnâmes
les recherches, et bientôt nous fûmes dans le train `en route' pour la
Convention de Dallas.
EXPÉRIENCES
A DALLAS
Arrivant
à Fort Worth à une heure matinale, il n'était pas pratique pour les amis de
nous accueillir, et nous prîmes le car électrique pour Dallas. La Foire d'État
de Dallas battait son plein, et chaque hôtel était bondé. A cause de l'état
physique de frère Russell, nous fûmes obligés de descendre du car avant
d'arriver à Dallas, de sorte que, lorsque nous arrivâmes à pied, après avoir
parcouru la longueur de sept « blocs »
(Amérique : un certain nombre de bâtiments réunis) par des rues encombrées,
toutes possibilités de joindre les frères étaient perdues. Ils nous trouvèrent,
non sans difficultés. Tous les hôtels étaient pleins à craquer et on nous
conduisit dans une maison meublée particulière où logeaient plusieurs des frères
venus à la Convention. Nous y demeurâmes le samedi et le dimanche jusqu'à
notre départ pour son prochain rendez-vous.
Frère
Russell termina la Convention de Dallas par une agape fraternelle et fut très
impressionné par le sérieux et l'évidente sincérité des amis du lieu. Ce
soir-là, il parla au public pendant deux heures et demie ; durant tout le
discours il y eut assez bien de perturbation à l'arrière de la scène par les
allées et venues d'une troupe qui devait jouer au théâtre dans la soirée.
L'un des membres de cette troupe reconnut que l'orateur était le Pasteur
Russell et demanda l'autorisation de participer au cantique final. Il avait une
voix forte et mélodieuse et se joignit à tous pour chanter de tout cœur
« Que tous saluent la puissance du nom de Jésus ! ». Après
un court repos à l'hôtel le plus proche, plusieurs d'entre nous partirent à
la gare, et là, nous eûmes de la peine à nous frayer lentement, le mieux que
nous pûmes, un passage à travers une foule compacte. Il nous fallut une bonne
demi-heure pour parvenir à notre train après notre arrivée à la gare. En
montant dans le train à Dallas ce soir-là, le 22 octobre, frère Russell était
fatigué et avait mal à la tête. Il prit un médicament et se retira.
A
l'arrivée à Galveston, le lendemain matin, il n'était pas bien du tout mais,
les frères ayant organisé une réunion pour la matinée, il consentit à
parler aux amis, à onze heure trente, après un discours de frère Sturgeon. A
cette réunion, il fit quelque chose que nous ne l'avions jamais vu faire
auparavant : il écrivit sur un morceau de papier son texte et un verset de
cantique, et dit aux amis qu'il avait fait cela afin de ne pas se tromper. Ce
papier est devant nous et nous y lisons :
« QUAND
CES CHOSES COMMENCERONT A ARRIVER, alors regardez en haut et levez vos têtes et
réjouissez-vous, sachant que votre délivrance approche » :
« Monte
chant solennel,
Que
tout pleur on supprime ;
Dans
ce pays d'Emmanuel,
A
nous le but sublime ! » (Traduction)
LE
DERNIER REPAS DE FRÈRE RUSSELL
Le
discours fut sténographié et sera imprimé au temps convenable. Frère Russell
dicta les dernières lettres immédiatement avant d'aller à cette réunion. A
la sortie, les frères l'emmenèrent en voiture sur le Sea Wall Boulevard. Il
semblait jouir de la brise embaumée de la mer et des magnifiques eaux mouvantes
du Golfe de Mexico. Durant la petite promenade sur le boulevard, un cher frère
fit part de ses difficultés à frère Russell et reçut son conseil. Neuf frères
dînèrent avec nous ce jour-là à l'Hôtel Galvez ; il répondit à leurs
questions et parut profiter de la communion et du repas. Ce devait être le
dernier repas que fit frère Russell. A partir de ce moment-là il ne prit plus
qu'un peu de jus de fruit, une gorgée ou deux d’œufs pochés, ou quelque
chose de semblable.
Bientôt
nous sortîmes pour la conférence publique de Galveston qui se tint dans une
salle spacieuse et belle mais, comme c'était le lundi après-midi, il n'y
avait guère plus de cinq cents personnes présentes. Pourtant, fr. Russell dut
faire un effort aussi dur et même plus dur et il se trouva très fatigué à la
fin de la conférence. Nous nous rendîmes en auto au bureau de poste et au
train ; des amis étaient là qui lui parlèrent et lui posèrent des questions
jusqu'au moment du départ, de sorte que lui ne mangea rien dans l'intervalle. A
7 h 45, nous étions à Houston où des amis empressés et zélés l'attendaient
et l'accompagnèrent pour se rendre à une salle de réunion bien remplie,
contenant quelque douze cents personnes auxquelles il parla pendant deux heures
et demie, ce qui faisait, pour ce lundi 23 octobre, un total de six heures de
discours. Était-il fatigué ? Était-il exténué et épuisé ?
Comme
il avait voyagé toute la nuit et gagné la demeure de sœur Frost, le mardi
matin, il ne fut pas surprenant de le trouver très souffrant physiquement. Ses
travaux se faisaient sentir plus que jamais ; son corps excédé de travail
commençait à se rompre à son point le plus faible. La cystite devenait aiguë.
Nous nous procurâmes différentes choses pour lui ce matin-là : en fait, tout
ce qu'il désirait, et il semblait savoir exactement ce qu'il voulait et
faisait. Il s'occupa fidèlement de son cas toute la matinée. Bien que nous
fussions allé chez un docteur qui était quelque peu intéressé à la Vérité
et qui aurait été heureux de venir le voir, il n'en manifesta pourtant pas le
désir. Il apprécia l'offre aimable, mais montra qu'il n'aurait pas besoin des
services d'un médecin. Il connaissait mieux lui-même son état, suivait très
sérieusement son traitement et avait sous la main un serviteur qui ferait
promptement et joyeusement tout ce qu'il désirait. C'était tout ce qu'il
voulait. Des fruits de premier choix furent placés juste à sa porte, mais il
n'y toucha pas.
La
situation empirait. Frère Russell signa quelques lettres que nous avions écrites,
nous laissa entendre que nous allions devoir faire un travail plus important que
nous ne nous le figurions et que nous devions le remplacer à la réunion d'onze
heures à la Salle. La sœur Frost mit généreusement son auto à notre
disposition, de sorte que nous pûmes aisément et rapidement aller et venir. Il
vint dîner avec nous, parla gentiment à chacun, et fut aussi plaisant que
d'habitude, mais il ne mangea rien bien que le repas fût excellent. Après le dîner,
nous montâmes ensemble l'escalier bras dessus, bras dessous jusqu'à sa
chambre. Après avoir causé un moment, il nous demanda d'assurer le service de
consécration à la Salle, à 15 h. C'est ce que nous fîmes, et ensuite nous
retournâmes immédiatement à sa chambre.
Puis,
je me rendis à tous les bureaux de poste de la ville à la recherche d'un télégramme
qu'il était certain de recevoir ici de Chicago, puisque nous ne l'avions pas reçu
à Dallas. Sa valise avait cependant été reçue à Dallas. Une fillette,
l'ayant trouvée dans Wichita, l'avait gardée jusqu'à ce qu'elle sût ce
qu'elle devait en faire par la note insérée dans le journal. Elle reçut sa récompense,
et fut contente. Frère Russell fut à plusieurs reprises déçu de ne pas
recevoir certains télégrammes. Au retour, nous restâmes près de lui le reste
du jour et, en fait, nous nous tînmes tout près de lui la semaine suivante.
Une semaine encore et il serait dans la gloire.
SON
DERNIER DISCOURS PUBLIC
La
nuit était venue. J'étais assis sur l'appui intérieur de fenêtre tout près
de lui, mes mains posées sur son genou et mon visage tourné vers le sien.
L'amour comme l'électricité coulait de visage à visage et de cœur à cœur.
Nous parlions à voix basse ; et, durant la conversation calme et charmante, il
me dit : « cher frère,
voulez-vous rester près de moi ce soir et vous tenir prêt à saisir le fil de
ma pensée à l'endroit où je l'interromprai ». Tout ceci semblait tout
à fait inaccoutumé, et pourtant était dit de telle manière que ce ne fût
point alarmant. Son compagnon était profondément impressionné et observait de
sa place, son visage, ses yeux et ses paroles ; il était méditatif et accepta
sans dire un mot.
La
conférence du soir eut lieu dans le plus vaste et le meilleur théâtre de San
Antonio. C'est, en vérité, un superbe édifice. Le parterre et les trois
balcons étaient remplis de visages sérieux et intelligents. Nous n'avons
jamais vu plus belle réunion. La conférence sur le sujet « le monde en
feu » commença dans les conditions les plus favorables. Vous pouvez vous
l'imaginer de votre mieux et vous ne vous tromperez pas de beaucoup.
Quand
tout fut prêt, à 20 h 10, frère Russell parut sur le devant de la scène et
commença son dernier discours public. Le spectacle était des plus beaux et des
plus impressionnants. J'étais assis à sa droite, derrière le rideau, et
pouvais voir chacun de ses mouvements. Tout se passa bien pendant
Il
revint la seconde fois après une absence de sept minutes et poursuivit son
discours. Il entretenait l'auditoire de la formation du premier credo à Nicée
par les Évêques sous la direction de l'Empereur romain Constantin, lorsqu'il
dut encore se retirer. Le fil de l'histoire fut facilement repris et suivi
pendant environ dix minutes, lorsque l'idée me traversa l'esprit : « je
me demande s'il ne désire pas que je termine le discours ? ». A ce
moment, notre cher instructeur rentra, juste à temps pour l'achever par une péroraison
très à propos. Ce fut une merveilleuse apothéose de tous ses discours
publics. Il me paraissait se tenir dans un halo de gloire. Dirigeant le grand
auditoire dans le chant du cantique 10 : « qu'à Jésus soit l'honneur
suprême ! » (Littéralement : « Que tous saluent la puissance du
nom de Jésus ! ») il pria d'une manière des plus impressionnantes, et
vint me retrouver où je l'attendais, lorsqu'il quitta la scène. Il s'assit
dans le fauteuil que j'avais utilisé et, pendant qu'il se reposait, un ami prit
plusieurs photos de lui. Comme ce sont les dernières, nous espérons qu'elles
seront les plus belles.
EN
ROUTE POUR LA CALIFORNIE
Nous
fûmes accompagnés jusqu'au train par la sœur qui nous avait reçus chez elle,
avait pourvu à tous nos besoins et de laquelle on peut dire en vérité :
« elle a fait ce qu'elle a pu ». Elle dit qu'elle avait été heureuse de briser le vase d'albâtre et
me remit assez d'argent pour prendre un wagon-salon Pullman de San-Antonio
jusqu'à notre destination de l'Ouest. Frère Russell refusa d'abord pensant que
c'était trop, mais il fut ensuite poussé à accepter l'offre aimable et il fit
bien, car cette nuit-là, il se leva trente six fois en sept heures !
Ce
fut tout de suite après avoir quitté San Antonio que j'eus le privilège et le
plaisir de délacer et d'enlever ses chaussures pour la première fois.
Jusqu'ici il ne l'aurait pas permis, bien que je lui en eusse fait l'offre
plusieurs fois ; mais maintenant il accepta instantanément et dit avec sa bonté
habituelle : « Je vous remercie ! ». Le lendemain matin, c'était un
malade bien qu'il ne fût pas disposé à l'admettre ; il garda le lit toute la
journée du mercredi. Lorsqu'il se mit dans sa couchette, je m'assis sur le lit
près de lui, surveillant chacun de ses mouvements, caressant sa tête, et
pensant à la somme prodigieuse de travail que ce cerveau avait accomplie ! Je
pris sa main droite douce et fine et la plaçai dans la paume de ma main gauche,
la caressant de ma droite ; je me souvenais de son discours de San-Antonio la
veille au soir et aux nombreuses fois où je l'avais vu se servir si
gracieusement de cette main quand il exposait les erreurs des « Credo »
des hommes en contraste avec la Parole de Dieu ; je lui dis : « Voilà la
plus grande main broyeuse de Credo que j'aie jamais vue ». Il me répondit
qu'il ne pensait pas qu'elle en broierait désormais encore.
Cela
me conduisit à demander : « Qui frappera le Jourdain ? ». A cela il
répondit : « Quelqu'un
d'autre peut le faire ». « Que pensez-vous du paiement du denier ? »
lui demandai-je. Après un moment d'hésitation, il dit : « Je ne sais pas
! ». Frère Russell était évidemment perplexe. Nous parlâmes alors de
sa condition physique. Ce qu'il dit concernant ses souffrances fut ceci :
«
J'ai toujours pensé que j'aurais quelques fortes souffrances avant
d'achever ma course et je pensais qu'il en était ainsi au moment de mes
difficultés à Pittsburgh. Mais si le Seigneur veut y ajouter encore celles-ci,
c'est parfait ».
Au
cours de cette conversation il dit : « qu'allons nous faire ? ».
Considérant la chose avec prière, je lui dis :
« Eh bien ! frère Russell, vous semblez connaître votre cas mieux
que quiconque, et vous avez pensé à tout ce qui peut être fait. Ai-je fait
tout ce que vous croyez que j'aurais dû faire ? ». Je n'oublierai jamais
sa voix. Ses paroles étaient remplies d'un océan profond de consolations
lorsque, d'une voix tranquille et faible, il répondit :
« Oui, vous l'avez fait ;
je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous ».
Chaque
mouvement qu'il faisait et chaque parole qu'il prononçait ne m'incitaient qu'à
penser au plus grave, et cependant j'arrivais difficilement à croire que la vie
du frère Russell touchait à sa fin. Ma pensée était la sienne et celle de
tous les amis que, probablement, il resterait ici le dernier et qu'il serait
enlevé après l’œuvre achevée. Ayant cela en tête, je répondis à sa
question en disant : « puisque
nous avons fait tout ce que nous pouvions et que vous vous affaiblissez toujours
plus, votre vitalité s'en va parce que vous ne mangez rien pour la soutenir. Je
pense que si nous retournions à Brooklyn, vous trouveriez là quelque chose qui
vous remettrait sur pied ». A cette suggestion, il répondit : « Le Seigneur nous a permis d'accomplir ce voyage ». J'en déduisis qu'il voulait dire par là : L'itinéraire que nous avons tracé,
et selon lequel tout notre programme avait été arrangé, représentait pour
nous la volonté du Seigneur et il nous fallait en conséquence faire le maximum
pour l'exécuter. A propos de cet itinéraire, l'auteur avait pensé à
l'origine, qu'après que frère Russell avait eu à supporter une saison d'été
RETENUS
A DEL RIO
Nous
filions rapidement à travers le sud du Texas sur le « Southern Pacific »
et nous nous approchions de Del-Rio, lorsqu'on nous fit savoir qu'en avant de
nous un pont avait été incendié pendant la nuit et que nous serions
vraisemblablement immobilisés là pendant quelque temps. Notre train stoppa à
Del-Rio, et nous nous trouvâmes au beau milieu d'un camp de soldats
frontaliers. Les soldats défilaient dans les rues, les fanfares jouaient et il
y avait partout beaucoup de vacarme. De surcroît, trois trains chargés de
troupes étaient garés à côté de nous, et ces hommes, n'étant pas autorisés
à descendre des wagons, braillaient sans arrêt et passaient le temps à toutes
sortes de frivolités et de farces. Cela dura tout ce jour-là et toute la nuit.
En outre, il faisait chaud à cet endroit. Mais jamais frère Russell ne proféra
une parole de plainte. Il ne fit même pas mention des soldats et du bruit.
Del
Rio étant une ville de quelque 10 000 habitants, il nous était possible d'y
trouver quelques articles indispensables. A un moment, nous suggérâmes à frère
Russell de nous laisser monter en ville pour consulter le médecin-chef, afin
d'avoir son idée sur ce qu'il y avait de mieux à faire dans un cas comme le
sien, sans lui laisser entendre pour quelle personne nous cherchions ce
renseignement ; mais cela ne lui parut pas être indiqué. Le maître d'hôtel
du wagon-restaurant connaissait frère Russell ; il vint le voir, se montra très
empressé envers nous et offrit de faire tout ce qui était en son pouvoir. Le
wagon-restaurant se trouvait à trois Pullmans en avant de nous. Nous devions
donc franchir cette distance pour aller chercher chaque petite chose nécessaire.
Après un jour entier de retard, nous quittâmes Del-Rio le jeudi matin, et fûmes
les premiers à passer sur le pont reconstruit.
Lorsque
notre train commença à franchir le pont, nous nous hâtâmes de le dire à frère
Russell. Nous arrivâmes au salon juste au moment où notre wagon parvint au
milieu du pont. L'en ayant informé, il s'assit sur son lit et regarda par la
fenêtre. Pendant ce temps nous étions de l'autre côté du pont ; sur ce, nous
fîmes cette remarque : « frère Russell, nous vous avons souvent entendu
parler du moment où nous passerions le fleuve, et maintenant au moins nous
l'avons passé ». Un doux sourire éclaira son visage, mais il ne dit pas
un mot. Nous commençâmes à penser qu'il pourrait trépasser, mais sûrement
pas à brève échéance. Nous étions en octobre, et il nous vint à l'esprit
que de même que nous avions eu un retard d'un jour avant de passer le fleuve
dans le Sud du Texas, ainsi pourrait-il se faire qu'il restât avec nous un jour
prophétique de plus et nous quitter vers octobre 1917. Avec ces pensées qui
traversaient notre esprit, nous faisions de notre mieux pour servir de toute
manière possible notre cher frère Russell patient, endurant et reconnaissant.
Il était difficile de lui faire boire de l'eau sans l'épancher, à moins que
nous le fissions s'asseoir. Il y avait énormément à faire nuit et jour et
nous estimions que c'était là un grand privilège. Nous avons souvent pensé
d'être fidèle le plus possible à cause des chers amis restés à la maison.
Le
vendredi soir, alors que nous arrivions à un point de jonction en Californie où
nous devions changer de train, frère Russell se leva, s'habilla comme de
coutume, quoique, naturellement, il fût très faible. C'est exactement ce que
nous pensions qu'il ferait quand le temps serait venu de sa prochaine réunion,
car il l'avait souvent fait auparavant. Toute la journée du samedi, souffrant
très fortement, très faible, et au milieu d'obstacles qui se dressaient devant
lui à tout moment, il se débattit comme un géant dans des questions
d'affaires. Nous n'avons jamais vu ni entendu parler de quoi que ce soit d'équivalent
à son héroïsme. Des amis l'avaient déçu, et il se demandait si le Seigneur
n'était point contre lui en certaines choses. Ses épreuves s'accumulaient et
s'intensifiaient ; il ne proféra ni un murmure, ni une plainte. Il avait promis
au Seigneur qu'il ne le ferait pas, et il tenait sa promesse. Il était si grand
que presque toujours j'hésitais à m'approcher de lui.
A
LOS ANGELES
Notre
train arriva à Los Angeles avec une heure ou plus de retard le dimanche matin,
29 octobre, et nous n'avions rien eu à manger. Les frères étaient réjouis de
nous voir, mais leurs visages changèrent d'expression quand ils virent notre
cher frère Russell. Ils se rendirent compte qu'il était faible, mais ils ne
savaient pas à quel point il était malade. En outre, lui même n'aurait pas
encore admis qu'il était réellement malade. Vers dix heures nous étions à
l'hôtel et je lui demandai si je ne pouvais pas obtenir qu'il mangeât un peu.
Il me répondit qu'il n'avait pas faim et me demanda de lui suggérer quelque
chose. Ce que je fis. Il consentit que je lui apporte quelque chose, mais n'en
goûta qu'un peu. Alors que je lui apportais son déjeuner, il me demanda si
j'avais pris le mien, et quand je lui répondis que non, il voulut savoir
pourquoi. Je lui dis que c'était parce que je voulais qu'il ait d'abord le
sien. Il me répliqua qu'il ne mangerait pas le sien tant que je n'aurais pris
le mien auparavant.
Voilà
comment était frère Russell, toujours plein de considération pour les autres.
Chaque fois qu'il me demandait de faire quelque chose pour lui, il disait :
« S'il vous plaît », et quand c'était fait, invariablement il
disait :
«
Je vous remercie » ! Il était étonnant ! Frère Homer Lee fit ce qu'il
put pour frère Russell pendant que nous étions là et, au moment de notre départ,
il me remit ses meilleurs remèdes espérant qu'ils lui feraient du bien. Les frères
de Los Angeles montrèrent leur bonté de toutes manières.
LE
DERNIER DISCOURS DE FRÈRE RUSSELL A L'ÉGLISE
Lorsque le moment de se réunir avec les amis l'après-midi arriva, frère Russell se leva et se prépara pour partir, les frères étant venus pour lui dans leur auto. Il était 16 h 30, ce dimanche, quand nous quittâmes l'hôtel pour aller à la réunion qui se tenait dans la salle même où avait eu lieu la Convention de Los Angeles durant la première partie de septembre. C'est une salle tranquille et convenable. Nous ne connaissons pas de local meilleur ou mieux approprié dans lequel frère Russell aurait pû donner son dernier message à l'Église. Il avertit les frères de ne pas révéler sa condition physique en ces mots : « Frères, ne me trahissez pas ».
Vous
savez que notre cher frère avait tant de considération des sentiments des
autres qu'il n'eut jamais beaucoup recours à la sympathie des amis ; il avait
tant le souci de leurs sentiments que très peu d'entre eux savaient combien il
avait souffert physiquement depuis trente ans. Une fois, récemment, il envoya
un mot à la famille de Béthel pour l'informer qu'il ne descendrait pas pour déjeuner
; un peu plus tard il m'informa qu'il n'était pas venu à cause des membres de
la famille qui avaient une sympathie tellement profonde pour lui qu'il n'aimait
pas prendre sur leur vitalité. Il avait appris à s'appuyer sur le seul Bras
Puissant ! Il n'avait pas particulièrement besoin de nous, mais nous avions
besoin de lui.
Nous
étions prêts à satisfaire chacun de ses désirs, c'est pourquoi personne
n'attira l'attention sur sa condition et, dans ce sens, ne le
« trahit pas ». Cependant, il se trahissait lui-même. Sa présence
seule en disait long à l'observateur perspicace. Bien plus, lorsqu'il se présenta
à l'avant de la scène pour commencer à parler, sans prendre en considération
le splendide auditoire qui était devant lui (car chaque siège était occupé),
il dit : « Je regrette d'être dans l'impossibilité de parler avec force »,
et il pria le président de déplacer la tribune et de lui apporter une chaise.
En s'asseyant, il dit : « Excusez-moi de m'asseoir, s'il vous plaît ».
Avec une profonde humilité et souffrant atrocement, il parla pendant
quarante-cinq minutes de la manière la plus solennelle, et ensuite pendant un
court moment répondit à des questions.
Finalement,
il déclara : « Il faut que je vous dise au revoir à tous et que je vous
donne un texte en souvenir — Nombres 6 : 24-26
(D.) :
« L'Éternel te bénisse et te garde ! L'Éternel fasse lever la
lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi ! L'Éternel lève sa
face sur toi et te donne la paix ».
Puisse
la bénédiction du Seigneur être richement avec
vous ; il a béni grandement
la classe de Los Angeles. Chacun devrait désirer faire sa propre part. Sans
s'occuper de ce que peuvent faire les autres, que chacun fasse sa part. Chantons
maintenant le cantique premier :
«
Doux esprit, colombe céleste,
«
Demeure avec la paix d'en haut,
« Guide
en nous fait, parole ou geste,
« Préside à nos efforts mentaux ».
CONSERVEZ CET ESPRIT AU MILIEU DE VOUS
Poursuivant,
il dit : « N'est-ce pas là une magnifique pensée ! ».
Conservez
cet esprit au milieu de vous. Ayez une parfaite confiance dans le Seigneur et
vous serez bien dirigés. Nous ne sommes pas venus à la Vérité par une parole
séduisante humaine quelconque, mais par la Parole de Dieu. Nous savons que le
Seigneur fera tourner toutes choses au mieux. Je vous souhaite à tous :
« Au revoir ! ». Ainsi, à 18 h 05, le dimanche 29 octobre, quand il
quitta cette tribune, il avait prononcé son dernier discours à l'Église de ce
côté du Voile pour toujours. Nos cœurs s'inclinent bien bas ! Nous adorons
humblement Dieu notre Père céleste, aux pieds de Jésus. Nous préférerions
garder le silence, mais pour l'amour de l'Église nous poursuivons :
Plusieurs
auraient voulu parler à frère Russell dans l'auto qui nous ramenait, mais ils
arrivèrent trop tard. Nous étions maintenant à la gare, et quand nous en sortîmes,
nous laissâmes quelqu'un derrière nous. Frère Sherman eut le privilège d'être
avec nous à la gare et de nous faire beaucoup d'amabilités. Quand frère
Russell signa son nom au guichet des tickets du chemin de fer de Kansas-City, ce
fut pour la dernière fois. Nous eûmes désormais le privilège de signer son
nom à sa place. Nous partîmes au train pendant que frère Sherman courait à
la pharmacie la plus proche pour y chercher quelque chose pour lui. Il revint à
18 h 30 et nous nous dîmes au revoir. Le train N° 10 de Santa Fe s'ébranla,
nous entrâmes dans le salon du wagon Roseisle ; en fermant la porte au verrou,
nous le séparions des autres pour toujours. Désormais, Gethsémané ! Victoire
! Gloire !
LE
VOYAGE DU RETOUR COMMENCE
Il m'avait fait placer divers objets dont il pouvait avoir besoin durant la nuit à des endroits convenables : sous les couvertures, sous son oreiller, sur les appuis de fenêtres de manière qu'il puisse les prendre sans me déranger. Nous fîmes exactement ce qu'il demandait, étant heureux de le faire, et nous le lui fîmes savoir. Il dit : « Je vous remercie ; vous êtes si complaisant que je vous ai demandé de faire certaines choses ». J'eus le plaisir d'être l'infirmier alors qu'il était à la fois le médecin et le patient (et combien exact était ce mot !). N'ayant plus besoin des services ni du médecin, ni de l'infirmier, ce dernier devint entrepreneur des pompes funèbres et accomplit les derniers rites solennels qu'il avait vu accomplir par d'autres auparavant. Je lui demandai délicatement : « Est-ce que tout va bien, frère Russell ? ». Il m'assura que oui, me remercia, et me pria de me reposer, en indiquant comment il appellerait s'il avait besoin de moi, me souhaita bonne nuit et se tourna sur son côté gauche, le visage vers la fenêtre.
Nous ne savons combien de temps s'était écoulé lorsque nous fûmes tiré du sommeil par son frappement et l'appel de notre nom — probablement deux heures environ. Mais nous allâmes vivement vers lui et, après lui avoir fait ce qu'il fallait, il nous dit encore « merci », et nous nous étendîmes de nouveau. Cependant, cette fois nous le fîmes avec la pensée que nous ne dormirions pas si profondément. Une heure plus tard, il frappait et appelait de nouveau ; nous allâmes près de lui et découvrîmes bientôt qu'une autre crise allait survenir. Il avait eu la première deux nuits auparavant. Nous plaçâmes cinq couvertures Pullman sur lui et le bordâmes fortement de chaque côté, mais il tremblait toujours. Nous lui donnâmes ce qu'il fallait et nous fûmes content lorsque les douleurs cessèrent. Nous restâmes à son côté, nous reposant de temps en temps sur la couche à côté de lui.
PRÉPARATIFS
POUR LA MORT
Vers le matin, il me fit faire une robe pour la convenance en épinglant un drap à l'intérieur d'une couverture pour l'envelopper comme d'une robe et en l'attachant sous son menton. Il se dressa dans ce but sur le parquet, puis s'étendit sur la couche au lieu de retourner à sa couchette. Je m'assis donc sur son lit alors qu'il reposait devant moi. Après plusieurs heures il se trouva que sa robe était plutôt incommode, le drap et la couverture ne pouvant être maintenus ensemble. C'est alors qu'il se leva de nouveau et me dit « Voulez-vous me faire une toge romaine ? ».
Je
ne compris pas ce qu'il voulait dire, mais je n'aimais pas le faire répéter,
car il était très faible. Sa voix était devenue si faible qu'il devait répéter
presque tout ce qu'il disait. Je lui avais dit plusieurs fois :
« Cher frère Russell, je n'aime pas vous demander de tout répéter
(j'avais toujours eu l'habitude de l'écouter si attentivement dans toutes ses
dictées qu'il n'avait pas besoin de répéter) ; mais votre voix est si faible
que l'on peut difficilement vous entendre ». Il dut répéter constamment
jusqu'au moment où la répétition ne donnât plus rien ; après quoi il fit
des signes. En fin de compte les signes cessèrent.
Je lui dis : « Frère Russell, je ne comprends pas ce que vous voulez dire ». « Je veux vous le montrer », répondit-il. Il me fit prendre un drap propre et fit un pli de 30 centimètres au sommet, puis je fis de même avec un second drap. Plaçant sa main gauche sur son épaule droite il dit : « Fixez-les ensemble ici ». Ayant en poche un carton d'épingles de sûreté que j'avais acheté récemment, il me fut facile de fixer ensemble les draps sur l'épaule droite et en même temps d'atteindre ma poche pour y prendre une épingle de sûreté. Les draps étant retenus par l'épingle comme il l'avait indiqué, il dit : « Fixez les maintenant ensemble sur l'autre épaule », ce que je fis. Il se dressa alors, un drap tombant de son cou jusqu'à ses pieds en avant, et l'autre derrière, retenus ensemble sur ses deux épaules et repliés ensemble sur les deux côtés. Il se tint debout devant moi un moment sans dire un mot, puis se coucha sur le dos dans son lit, ferma les yeux, et demeura là devant moi comme dans un linceul, tableau parfait de la mort.
Je
m'assis sur le bord du lit, le veillant, le regardant, et la pensée de la mort
traversa mon esprit. Il m'était difficile de me faire entrer dans la tête la
pensée que frère Russell allait mourir. Je ne pouvais pas tout à fait y
croire, pas même maintenant. Cela paraissait si éloigné de ce que nous avions
attendu. Cependant, je sais maintenant que le Seigneur nous enseignait à tous
deux, graduellement, depuis le moment de notre départ de San Antonio jusqu'à
maintenant que la fin de frère Russell approchait rapidement. Nous ne pouvons
connaître exactement tout ce que frère Russell pouvait avoir compris ou voulu
dire par ces mouvements. C'était au moins les choses les plus sages qui
pouvaient être faites dans son cas, mais ces mouvements signifient pour nous
davantage, et nous croyons que le Seigneur l'a voulu ainsi. La toge était portée
par des personnages officiels romains et quelquefois par des prêtres ; parfois,
elle symbolisait la victoire et la paix et, à d'autres occasions, que celui qui
la portait avait accompli ses vœux. Dans l'esprit de l'auteur, toutes ces
choses sont représentées. Il avait accompli ses vœux ! Il avait gagné la
victoire ! Il était en paix ! Désormais, une couronne de justice lui était réservée
que le Seigneur placerait bientôt sur son noble front.
CONCERNANT
LE VOLUME VII
Avec
les scènes qui se passaient devant moi et les pensées de la fin qui me
traversaient l'esprit, il n'était que naturel que je me dise : Ne serait-il pas
opportun que vous interrogiez frère Russell concernant certaines choses ? Ce
fut dans cette disposition et dans ces circonstances que nous le questionnâmes
concernant le 7ème volume,
à quoi il répondit : « Un
autre peut l'écrire ». La réponse nous satisfit. Il avait parlé
concernant le frappement du Jourdain, le paiement du denier et la rédaction du
septième volume et cela était suffisant. Rien n'était laissé pour le doute
ou la crainte. Nous croyons qu'il a dit tout ce qu'il désirait dire, et que le
Seigneur donna par son entremise tout ce qu'il désirait que l'Église eût
touchant ces sujets essentiels, vitaux et importants. Frère Russell paraissait
n'avoir aucun désir (pas plus qu'il ne semblait y avoir nécessité) de faire
à la fin de sa vie un tas de petites choses qui auraient été laissées
inachevées. Il avait terminé sa course. Ses
œuvres étaient terminées. Il était
prêt à être offert.
Nous fûmes solennellement occupé toute la journée du lundi, à tel point que nous n'eûmes pas le temps de dîner ni de souper. Lorsque la nuit vint, il était sur sa couchette et je m'étendis tout habillé sur le lit pour prendre quelque repos. J'étais juste sur le point de sombrer dans le sommeil, quand il me sembla entendre ces mots : « Frère Sturgeon ! ». En venant à lui, les expériences de Samuel me traversèrent l'esprit. Je me penchai sur lui et lui dis : « Frère Russell, m'avez-vous appelé ? » Il me dit : « Oui » et il me donna quelque petite chose à faire, après quoi je m'étendis pour la seconde fois. Peu de temps après, il me sembla m'entendre appeler de nouveau. Comme auparavant, je me penchai très près de lui et l'entendis murmurer : « J'essaye de vous trouver quelque chose à faire ». De ceci je conclus « frère Russell désire que je veille toute la nuit » ; et il se trouva qu'il devait en être ainsi.
L'APPROCHE
DE LA MORT
Je
fis une série de nombreuses petites choses conformément à ses paroles ou
signes, jusqu'à ce qu'une autre crise (la troisième) survînt. J'entassai
couverture sur couverture sur lui et l'en enveloppai, mais il tremblait
toujours. Je me couchai contre lui appliquant mon visage sur le sien, jusqu'à
ce que je sentisse la chaleur revenir sur son corps. Le fait que c'était la
troisième crise en quatre nuits renforçait l'impression dans mon esprit que la
fin était proche.
Vers
minuit, un grand changement se produisit en lui. Il ne se soucia plus d'aucun de
ses médicaments, et ne parut même plus désireux de boire de l'eau comme
auparavant. Certaines choses avaient presque cessé. Sa souffrance augmentait.
Il ne pouvait plus demeurer droit dans son lit comme avant. Il devait s'asseoir,
et quand il voulait se coucher, il se pliait en deux et sa tête restait droite
vers la fenêtre sans reposer sur l'oreiller. Il demeurait un petit moment
tranquille dans cette position, jusqu'à ce que sa bouche se remplît de matières
provenant de son estomac et qu'il fit signe de le lever. Étant débarrassé de
cela, il désirait se recoucher pour être plus à l'aise jusqu'à ce que, pour
éviter de s'étrangler, il fût de nouveau relevé. De cette manière et avec
l'attention voulue, il pouvait s'étendre à nouveau pour se soulager de son
mal.
Cela
dura pendant sept heures avec une fréquence et une faiblesse accrues. Il ne
pouvait plus exprimer ses désirs en paroles ; il devait le faire par des
signes. Lorsqu'il était couché en travers du lit et qu'il désirait être levé,
il levait sa main et son bras droits de telle manière que ma tête se trouvât
dans l'incurvation de son bras et il se penchait sur mon cou tandis que mon bras
gauche entourait son cou et de cette manière le levait dans la position assise.
Cela continua jusqu'à ce que la pensée me vint de me demander qui serait le
premier épuisé. Je pensais aux amis de la maison (de Béthel) et aux nombreux
amis intéressés de partout. Je m'attendais au Seigneur et m'encourageais
disant : « Je veux rester avec lui jusqu'au bout ».
A
l'aube, il se laissa aller. Il était exténué et je pus maintenant le laisser
étendu sur le lit, la tête sur l'oreiller à sa place accoutumée, et enfin il
put se reposer. Le calme avait suivi la tempête. Il se mourait graduellement, régulièrement,
paisiblement ; je n'avais plus qu'à me tenir debout près de lui, vigilant,
l'aimant et lui exprimant mon affection en caressant doucement ses cheveux et sa
barbe et en frictionnant sa tête, ses mains et ses pieds. Je me trouvais
incapable de faire assez pour lui, maintenant qu'il avait passé au-delà d'une
certaine ligne.
LES
DERNIÈRES HEURES
A
différentes reprises, le lundi, je le redressai sur son lit, m'asseyant derrière
lui de manière à le prendre dans mes bras, et sa tête s'appuyait contre la
mienne. Une fois il chuchota : « Avez-vous
quelque chose à suggérer ? ». C'était le cas. Je désirais qu'il
retournât directement à Galveston et qu'il prit le bateau pour New York, ou
alors qu'il prît le train sans s'arrêter à Topéca, Tulsa ou Lincoln. Il me répondit
: « A chaque jour suffit sa
peine ! ». Sur quoi, je compris que Topéca et chaque endroit prendraient
soin d'eux-mêmes quand nous y parviendrions et que nous n'avions pas à nous en
occuper d'avance. Ce fut alors que je le questionnai au sujet du volume VII ;
après quoi je m'assis, méditant sur ce que je pourrais suggérer. Après un
moment de silence total, je pensai à lui parler de la mort et de certaines
choses qui s'y rattachent, mais j'hésitais et ne savais pas trop de quelle manière
commencer.
Il
était en train de s'asseoir dans son lit et je plaçai mon bras autour de son
cou en lui disant : « Frère Russell, vous êtes très malade ».
Ses lèvres tremblaient ; nous l'étendîmes et détournâmes la tête pour
pleurer. J'avais fait au-delà de ce que je pouvais faire ; je ne pouvais
recommencer. Il était évident que ni lui ni moi ne pouvions le supporter et
qu'il n'y avait rien de plus à faire.
Ce
qui est le plus étonnant chez cet homme merveilleux, c'est que durant toutes
ses souffrances, épreuves, malaises et angoisses, il ne proféra pas un mot de
plainte, il ne poussa pas un soupir, il ne fit entendre aucun gémissement, il
ne versa pas une larme. Il avait résolu de ne murmurer ni de se plaindre, et il
tint sa résolution jusqu'à la fin. Il mourut littéralement en faisant la
volonté du Père, et accomplit ainsi son vœu. « Heureux, désormais les
morts qui meurent dans le Seigneur ».
LA
MORT DE FRÈRE RUSSELL
Nous
veillâmes à son côté pendant toute la matinée du mardi, n'ayant que peu de
choses à faire, sauf de veiller et prier. Remarquant que nous étions le
dernier jour d'octobre, nous en conclûmes qu'il mourrait avant minuit et, en
conséquence, nous adressâmes le télégramme suivant aux amis de Brooklyn :
« Avant qu'octobre s'achève, notre bien-aimé frère Russell sera dans la
gloire avec le Seigneur. Nous sommes seuls dans le wagon Roseisle du train de
Santa Fe, n° 10, qui doit arriver à Kansas City mercredi matin à 7 h 35. Il
meurt en héros. Après l'embaumement, nous rentrerons avec ses restes, ou bien
nous irons directement à Pittsburgh ». Nous fîmes venir le surveillant du
Pullman et également le responsable du salon et nous leur dîmes : « Nous
voulons que vous voyez comment peut mourir un grand homme de Dieu ». Le
spectacle les impressionna profondément, principalement le responsable du
salon. Je fis appeler le chef de train et je télégraphiai pour qu'un docteur vînt
faire le constat dans le train à Panhandle, ce qu'il fit. Il constata la
situation, reconnut l'exactitude du diagnostic et de sa conclusion. Il me donna
son nom et descendit du train avant qu'il reparte.
A
une heure, tous avaient quitté la chambre ; la porte fut fermée et nous veillâmes
sur lui dans le silence jusqu'à ce qu'il rendît le dernier soupir. Nous avions
observé les signes précurseurs de la mort avant d'appeler le personnel du
train. Ces signes durèrent jusqu'à ce que les ongles des doigts fussent décolorés,
qu'une sueur froide perlât sur ce noble front, que ses mains et ses pieds
fussent glacés, que son visage marquât une rupture et qu'il étendit ses pieds
dans le lit comme le fit autrefois Jacob. Sa respiration calme se ralentit, ses
paupières baissées s'ouvrirent comme les pétales d'une fleur et découvrirent
ses yeux — ses yeux étonnants ! dans toute leur magnificence — que nous
n'oublierons jamais. A présent son souffle avait cessé ; nous pressâmes nos lèvres
sur son noble front, et nous comprîmes qu'il était parti pour être à jamais
avec le Seigneur qu'il avait tant aimé, et pour être fait semblable à lui.
« Cher Seigneur, que je sois l'ange en Gethsémané !
« Remplis-moi
de l'Esprit de Ta plus haute grâce ; (*) [L'amour]
«
Oh, rends-moi sage et doux, bon pour l'infortuné,
«
Afin que ta Parole apaise son angoisse.
«
Et que fort il affronte géole comme gibet ;
« Qu'il souffre des moqueurs la langue déloyale,
«
Porte la lourde croix jusqu'au bout, sans regret
«
Et dise : « C'en est fait ! « en passant sous `le voile ! »
(Reprints,
pp 6001 à 6006)
SCÈNES
FINALES A NEW YORK ET A PITTSBURG
L'oraison
du soir, la lecture du sermon que frère Russell avait lui-même préparé
pour être prononcé au Temple ce soir-là, et les doux accents de plusieurs
cantiques étaient toujours à l'esprit du vaste auditoire lorsque les porteurs
enlevèrent du Temple le cercueil contenant les restes de notre cher frère
Russell. Deux wagons Pullman bondés d'amis dévoués et fidèles accompagnèrent
le corps à Pittsburgh où ils étaient attendus par des centaines de bien-aimés
de cet endroit.
Le
lendemain, à 14 h 00, la grande salle de la Bibliothèque Carnégie à
Allegheny était remplie quand la quatrième partie des services funèbres
commença sous la direction du Dr W.E. Spill, représentant l'assemblée de
Pittsburgh. L'amour et un intérêt profond étaient également marqués sur
chacun des visages de ce vaste auditoire. Chaque place disponible de la scène
était utilisée pour le déploiement des riches offrandes de fleurs de toute
nature envoyées par des Étudiants et amis de la Bible des différents lieux du
pays.
L'union des voix composant le double quatuor dans l'interprétation des doux hymnes chrétiens apporta la consolation et l'encouragement à beaucoup de cœurs attristés. Après la lecture des Saintes Écritures par frère R.F. Bricker, également de l'ecclésia de Pittsburgh, le Dr W.E. Spill prononça une allocution. Il fut suivi par frère Sturgeon, après quoi, tandis que l'assemblée défilait une dernière fois devant le visage du noble chrétien reposant devant eux, le chœur chanta le dernier cantique choisi par frère Russell au cours de sa dernière visite à l'ecclésia de Los Angeles :
«
Doux esprit, colombe céleste,
« Demeure avec la paix d'en-haut... »
Le
cortège funèbre se composait de 101 automobiles et d'un train de plusieurs
tramways. Le magnifique cimetière de Rosemont fut atteint à la brume ; un
groupe de 500 frères était là rassemblé sur le versant de la colline pour
rendre les derniers et tristes rites à la mise en terre de notre bien-aimé. Une
avenue bordée de fleurs fut formée par laquelle passèrent les porteurs nu-tête,
portant solennellement le cercueil contenant les restes de notre Pasteur. Les côtés
de la tombe étaient bordés de fougères et de chrysanthèmes blancs. Au pied
de la tombe était placé un motif floral paré de couleurs d'or, qui exprimait
silencieusement la conviction que le victorieux soldat chrétien, dont le corps
reposait devant nous, avait gagné le « home » et participait
maintenant de la nature divine.
Pendant
que le cercueil reposait sur les tréteaux au-dessus de la fosse, une prière
fut offerte et le cercueil fut descendu jusqu'à son dernier lieu de repos,
alors que le chœur chantait d'une manière impressionnante les magnifiques
paroles du cantique N° 98 - cantique N°
98 en anglais
Il
était tout à fait approprié que, tandis que notre bien-aimé était parti
pour toujours avec le Seigneur pour être fait semblable à Lui, ses restes
reposassent près des anciens sites où l’œuvre de la Moisson avait commencé
et où les ÉTUDES DANS LES ÉCRITURES qui contribuèrent tant à son renom
furent écrites et diffusées en premier.
Menta
STURGEON,
Frère Pèlerin et secrétaire du Pasteur Russell
(W.T. 1er décembre
1916)
Reprints, page 6016
LES
VAINS TRÉSORS TERRESTRES
Combien
tout est vain sous les cieux,
Combien
passagère est la joie ;
Qu’ils
sont frêles en ces bas lieux,
Les
liens que la vie octroie.
Perles
du jour, brumes des soirs,
Défuntes
fleurs, herbe fanée
Sont
images de nos espoirs,
Gloire
d'à peine une journée.
Mais
quoique sur terre à présent,
Toutes
choses soient incertaines
Un
âge béni vient, exempt
D'illusions,
soucis et peines.
Donc,
assurés de jours meilleurs,
Par
Dieu qui nous aime, nul doute,
Traversons
ce pays des pleurs ;
Fermes sur la céleste route.
Hymne de l'Aurore Millénaire n° 98